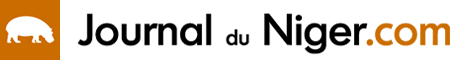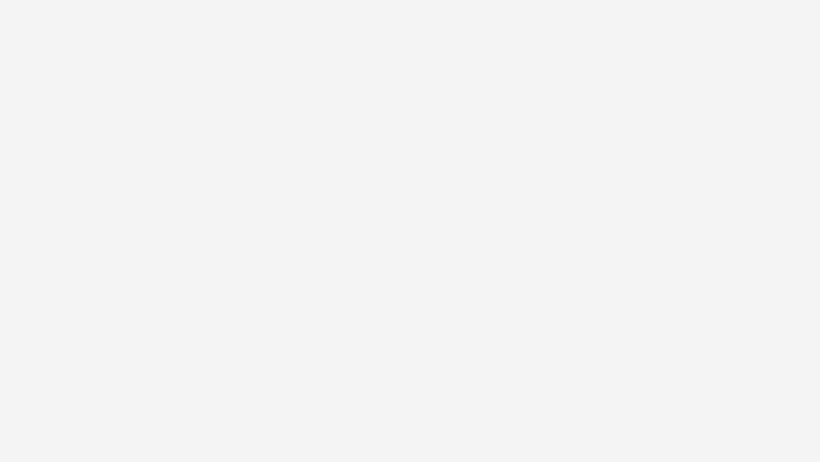Un tribunal turc a acquitté mardi plusieurs figures majeures de la société civile, dont le célèbre mécène Osman Kavala, une décision inattendue annoncée à l’issue d’un procès emblématique de l’érosion des libertés en Turquie.
Le tribunal de Silivri, près d’Istanbul, a acquitté M. Kavala et huit co-accusés qui comparaissaient mardi « en l’absence de preuves suffisantes » pour appuyer les accusations de « tentative de renversement du gouvernement », selon une correspondante de l’AFP.
Les accusés étaient poursuivis pour leur implication dans des manifestations antigouvernementales en 2013, connues sous le nom de mouvement de Gezi, visant l’actuel président Recep Tayyip Erdogan, alors Premier ministre.
Pour nombre d’ONG, ce procès, qui reposait sur peu d’éléments concrets, visait à envoyer un message d’intimidation à la société civile pour dissuader toute nouvelle manifestation d’envergure contre le président Erdogan qui dirige la Turquie depuis 2003.
Le tribunal a par ailleurs ordonné la remise en liberté de M. Kavala, un homme d’affaires et philanthrope incarcéré depuis plus de deux ans dans le cadre de cette affaire qui a suscité la vive inquiétude des ONG et des pays occidentaux quant à la situation des libertés en Turquie.
Après l’annonce de cette décision, les dizaines de personnes présentes au tribunal pour soutenir les accusés ont applaudi à tout rompre, selon la journaliste de l’AFP.
Le tribunal a en outre dissocié les dossiers de sept autres accusés qui n’étaient pas présents au tribunal, dont le journaliste Can Dündar, qui s’est exilé en Allemagne.
Son emprisonnement a fait de M. Kavala le symbole de la répression orchestrée contre la société civile en Turquie, en particulier depuis une tentative de putsch en 2016 contre M. Erdogan suivie de purges massives.
M. Kavala, connu des cercles intellectuels en Europe, était notamment accusé d’avoir financé le mouvement de Gezi. Il risquait la prison à vie.
– « Immenses souffrances » –
« Les acquittements prononcés aujourd’hui sont la bonne décision. La remise en liberté d’Osman Kavala n’a que trop tardé », a déclaré à l’AFP la représentante en Turquie de l’ONG Human Rights Watch, Emma Sinclair-Webb.
« Toute cette affaire a causé d’immenses souffrances à ceux qui ont été visés à tort, à commencer par Osman Kavala. C’est un procès dont le seul but était de s’en prendre à des défenseurs des droits humains », a-t-elle ajouté.
Le mouvement de Gezi a commencé avec un sit-in pour défendre le parc de Gezi, l’un des rares espaces verts au cœur d’Istanbul. Après une répression brutale, il s’est transformé en mouvement plus global contre M. Erdogan.
Hétéroclite, le mouvement rassemblait pêle-mêle des militants écologistes, des étudiants manifestant pour la première fois, des associations défendant les droits des femmes ou encore des musulmans anticapitalistes.
L’affaire est brusquement revenue sur le devant de la scène en 2018 lorsque le président Erdogan a commencé à présenter le mouvement Gezi comme une « tentative de coup d’Etat » préfigurant une tentative de renversement, bien réelle celle-là, en juillet 2016.
Dans son acte d’accusation de 657 pages, le procureur présentait le mouvement de Gezi comme une opération pilotée de l’étranger pour nuire à la Turquie.
En décembre, la Cour européenne des droits de l’Homme avait réclamé la libération immédiate de M. Kavala, soulignant l’absence de « faits, informations et preuves » dans l’acte d’accusation.
Parmi les éléments de l’accusation figurait une carte de la répartition des abeilles sur le territoire turc, trouvée dans le téléphone de M. Kavala. Le document a été présenté comme une preuve que le mécène entendait redessiner les frontières du pays.
Le président Erdogan a plusieurs fois attaqué nommément M. Kavala, l’accusant de « financer les terroristes » et d’être « le représentant en Turquie » du milliardaire américain d’origine hongroise George Soros, bête noire de plusieurs dirigeants autoritaires dans le monde.
La décision rendue mardi intervient quelques jours après l’acquittement de la célèbre romancière Asli Erdogan dans un autre procès symbolique où elle était accusée d’activités « terroristes ».