Une alliance audacieuse pour métamorphoser l’industrie aurifère nigérienne
Ce mercredi 23 avril, dans l’enceinte solennelle de la Maison de l’Uranium à Niamey, le gouvernement de la République du Niger a paraphé un accord de joint-venture d’une portée considérable avec la société Suvarna Royal Gold Trading LLC. De cette union naîtra la Royal Gold Niger SA, une entité appelée à insuffler une dynamique novatrice dans l’exploitation des ressources minières du pays.
En effet, l’ambition affichée est d’ériger une raffinerie d’or, d’établir une unité de confection de bijoux et d’édifier un atelier dédié à la taille et au polissage des pierres précieuses. Ainsi, ce projet, dont les contours ont été scellés par le ministre des Mines, le Commissaire-Colonel Abarchi Ousmane, son homologue du Budget, M. Mamane Sidi, et le PDG de Suvarna, M. Pattni Kamlesh Mansukhal Damji, s’annonce comme une étape cardinale dans la quête d’une souveraineté économique affirmée.
 Un dessein structurant pour l’économie nationale
Un dessein structurant pour l’économie nationale
Bien loin de se limiter à une simple extraction brute, cette initiative aspire à transfigurer l’or nigérien en un levier de prospérité tangible. « Désormais, l’or puisé dans nos terres ne quittera plus nos frontières sous sa forme primaire ; il sera sublimé ici même, au bénéfice exclusif de notre peuple », a proclamé le ministre des Mines avec une gravité empreinte d’espoir. Cette mutation s’inscrit dans une vision plus vaste, portée depuis 2023 par le Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP).
À cet égard, ce dernier, fer de lance d’une refondation nationale, entend tisser une stratégie dans laquelle chaque segment de la chaîne de valeur minière, de l’extraction à la transformation, puis à la mise sur le marché, soit maîtrisé avec une rigueur méthodique. Ainsi, le Niger ambitionne de s’affranchir d’un modèle économique où ses richesses, jadis exportées sans valorisation, profitaient davantage à des entités étrangères qu’à ses propres citoyens.
Une réponse pragmatique aux défis de l’orpaillage artisanal
Par ailleurs, depuis les années 1950, l’orpaillage artisanal demeure une ancre vitale pour des milliers de foyers nigériens. Pourtant, ce secteur, livré à une informalité chronique, souffre d’une vulnérabilité aux réseaux clandestins et d’une gestion souvent désordonnée. Face à ce constat, le ministre Abarchi Ousmane a martelé la nécessité d’ordonner cette filière séculaire. « Nous devons la structurer avec soin, la préserver des emprises illégales et l’ériger en source pérenne de revenus fiscaux, d’emplois stables et de savoir-faire locaux », a-t-il énoncé. En conséquence, la Royal Gold Niger SA se veut ainsi le creuset d’une formalisation raisonnée, où la traçabilité des ressources et leur exploitation réfléchie garantiront un essor durable, loin des dérives du passé.
La souveraineté aurifère comme horizon indéfectible
En outre, ce partenariat transcende la sphère économique pour s’ériger en acte politique d’une rare densité. En s’associant à cette joint-venture, l’État nigérien revendique une emprise résolue sur ses trésors naturels. « Nous affirmons notre détermination à ce que les fruits de nos sols irriguent d’abord notre nation, pour les générations d’aujourd’hui comme celles de demain », a insisté le ministre. Cette posture rompt avec une histoire dans laquelle les bénéfices de l’exploitation minière s’évanouissaient trop souvent au-delà des frontières. Désormais, le Niger se dote d’un instrument pour façonner son destin, en puisant dans ses ressources une force de dignité et d’autonomie.
Une synergie féconde avec Suvarna Royal Gold Trading LLC
Le choix de Suvarna Royal Gold Trading LLC comme partenaire n’a rien d’une coïncidence. Cette entreprise, reconnue pour son expertise dans le négoce de l’or physique et la gestion de la ferraille, apporte un savoir-faire précieux à cette entreprise colossale. Son dirigeant, M. Pattni Kamlesh Mansukhal Damji, n’a pas manqué de louer les termes de cette collaboration, qu’il juge en parfaite harmonie avec les aspirations des autorités nigériennes. Ensemble, les deux parties entendent conjuguer compétences locales et internationales pour bâtir une industrie aurifère intégrée, capable de rivaliser sur les scènes régionales et mondiales.
 Un élan vers une prospérité inclusive
Un élan vers une prospérité inclusive
Au cœur de ce projet réside une promesse : celle d’une économie nationale où chaque parcelle d’or transformée engendre une richesse palpable pour le peuple. « Nous posons les fondations d’un modèle intégré, où la valeur ajoutée profite à nos concitoyens, tout en cultivant des aptitudes nouvelles et des emplois qualifiés », a détaillé le ministre. Si le parcours s’annonce exigeant, les premiers pas sont franchis avec une assurance manifeste. « Par cet accord, nous ne nous contentons pas de parapher un document ; nous gravons une empreinte dans le marbre de notre histoire », a-t-il conclu, le regard tourné vers un avenir qu’il espère radieux.
Un jalon vers une nouvelle ère aurifère
En somme, cette alliance marque un tournant décisif dans la trajectoire du Niger. Elle incarne une volonté inébranlable de transmuer les richesses du sous-sol en vecteurs d’un développement équitable et pérenne. Par ce geste, le pays s’équipe pour façonner son avenir économique tout en s’ouvrant à des coopérations internationales respectueuses de son indépendance. Si l’horizon reste à conquérir, le Niger, par cette démarche résolue, s’est indéniablement engagé sur la voie d’une renaissance aurifère ambitieuse.



 Un contexte de rupture et de reconstruction présenté aux diplomates
Un contexte de rupture et de reconstruction présenté aux diplomates Une diplomatie ancrée dans le respect et le multilatéralisme
Une diplomatie ancrée dans le respect et le multilatéralisme

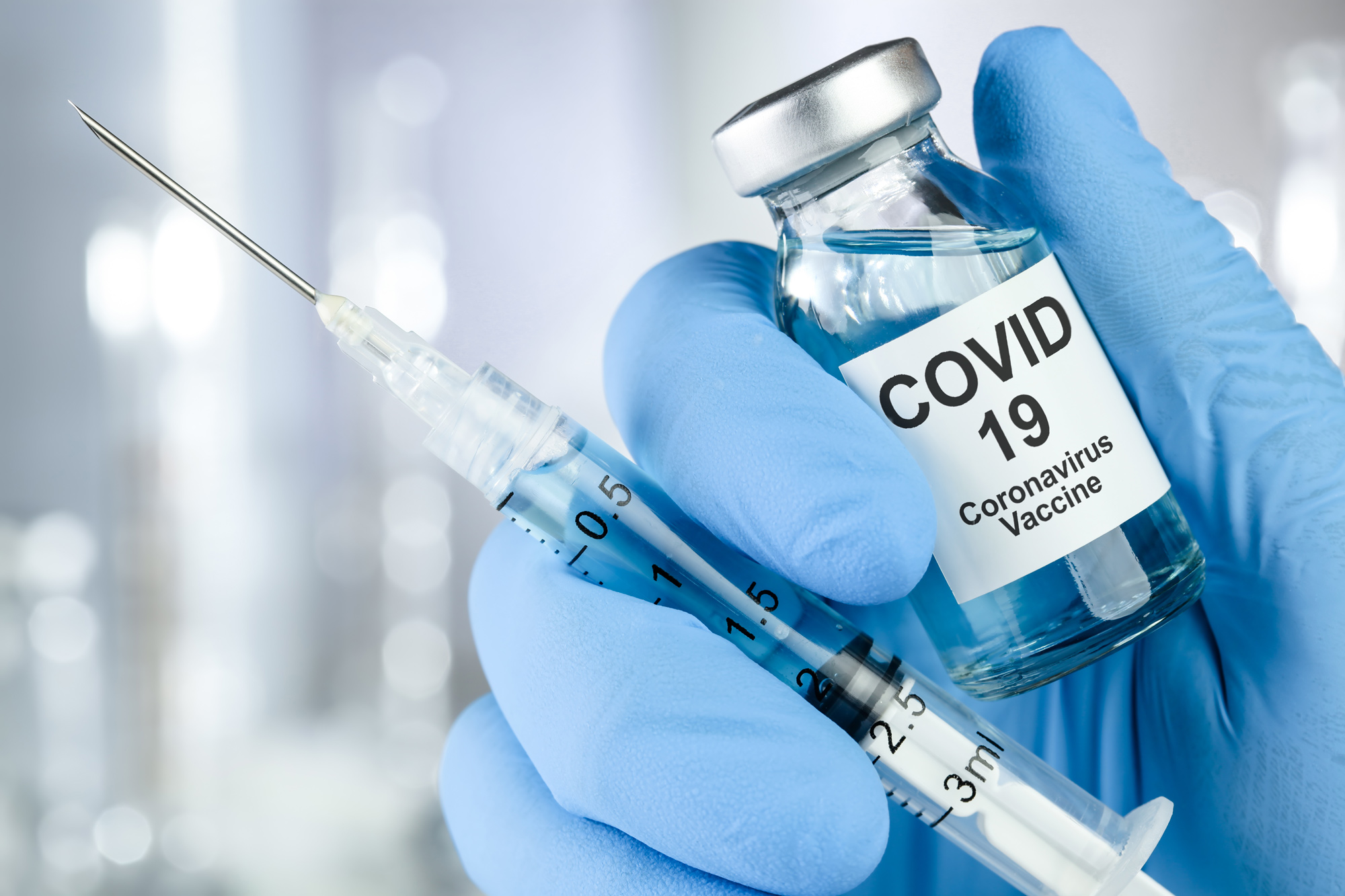

 Garchinguiligui : Une riposte foudroyante face à l’audace terroriste
Garchinguiligui : Une riposte foudroyante face à l’audace terroriste Garchinguiligui : Le gouverneur Bagadoma célèbre le courage des troupes
Garchinguiligui : Le gouverneur Bagadoma célèbre le courage des troupes Une région sous tension, un combat inlassable
Une région sous tension, un combat inlassable Une victoire, mais un horizon incertain
Une victoire, mais un horizon incertain
 Le pape François : une veillée funéraire empreinte de simplicité
Le pape François : une veillée funéraire empreinte de simplicité Une vague d’émotion mondiale et la présence de dirigeants
Une vague d’émotion mondiale et la présence de dirigeants Un ultime message d’espérance
Un ultime message d’espérance
 Un engagement d’envergure pour l’artisanat nigérien
Un engagement d’envergure pour l’artisanat nigérien Une programmation dense et multidimensionnelle
Une programmation dense et multidimensionnelle Le MIATO : une plateforme de rayonnement et d’innovation
Le MIATO : une plateforme de rayonnement et d’innovation
