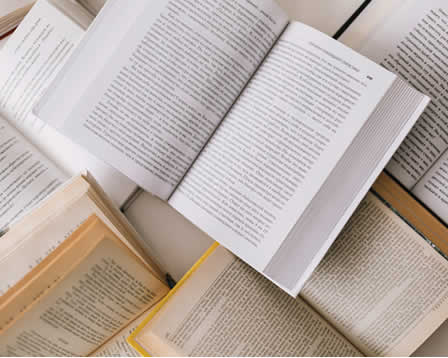Pékin, 8 avril 2025 – En ce printemps, un vent d’innovation souffle sur les terres pakistanaises, porté par une décision majeure venue de Pékin : la Chine a donné son aval à la construction d’une usine de fabrication de véhicules électriques par le titan BYD, pour un investissement colossal de vingt milliards de dollars. En effet, ce projet, qui prendra racine à Karachi, dans la province du Sindh, marque une étape décisive dans l’ambition du géant chinois (coté sous le code 002594.SZ) de conquérir de nouveaux horizons. Par cette initiative, BYD ne se contente pas d’exporter ses modèles ; il sème les graines d’une révolution énergétique dans un pays où les nouveaux véhicules électriques (NEV) demeurent une rareté, freinés par un réseau de recharge encore embryonnaire.
Une implantation aux promesses audacieuses à Karachi
L’annonce, vibrante d’assurance, révèle l’intention de BYD d’ériger une usine de production automobile au cœur de Karachi, métropole tentaculaire et poumon économique du Pakistan. Ce choix n’est pas fortuit : la ville, avec son port stratégique de Qasim, s’impose comme un carrefour industriel où voisinent déjà des usines de constructeurs tels que Toyota, Suzuki et Kia. En s’associant à Mega Motors, filiale du puissant groupe énergétique Hub Power Company (Hubco), BYD s’apprête à introduire trois modèles sur le marché local : deux SUV, dont le Sealion 6 et l’Atto 3, ainsi qu’une berline, la Seal. Ces véhicules, dont les ventes débuteront dès le quatrième trimestre 2024, incarnent une promesse d’accessibilité à une mobilité plus propre dans un pays où les infrastructures de recharge restent un défi à relever.
Une alliance pour surmonter les obstacles
Le partenariat avec Mega Motors ne se limite pas à une simple collaboration commerciale. Hubco, par son engagement à déployer des stations de recharge rapide dans les grandes villes, le long des autoroutes et des routes principales, entend pallier l’une des lacunes majeures du Pakistan : l’absence d’un réseau électrique adapté aux NEV. Par ailleurs, Cette synergie illustre une leçon limpide : la transition énergétique ne saurait prospérer sans une harmonie entre production et infrastructure. L’usine, dont les opérations devraient démarrer en 2026, produira des véhicules d’une modernité tranchante, conçus pour répondre aux exigences locales tout en s’inscrivant dans une vision globale de durabilité.
Un investissement aux multiples retombées
L’envergure de cet investissement – vingt milliards de dollars – ne se mesure pas seulement en chiffres, mais en potentialités. Située près du port de Qasim, l’usine s’étendra sur un site industriel déjà rompu aux exigences de la production automobile. Elle promet non seulement de créer des emplois, mais aussi d’insuffler une dynamique d’innovation dans un secteur pakistanais dominé par les constructeurs japonais. BYD, fort de son statut de leader mondial des NEV avec trois millions de véhicules vendus en 2023, apporte au Pakistan une expertise rare, celle d’une entreprise qui maîtrise la fabrication de batteries et de systèmes électriques avancés. Cette implantation pourrait, à terme, faire du pays un pôle régional pour les technologies vertes.
Une école de progrès pour le Pakistan à Karachi
En plus, ce projet offre au Pakistan une occasion singulière d’apprendre et de grandir. En accueillant BYD, le pays s’ouvre à une modernité qui dépasse la simple production automobile : il s’agit d’embrasser une philosophie dans laquelle l’énergie propre devient un levier de prospérité. Les défis, toutefois, ne manquent pas. La réussite de cette entreprise dépendra de la capacité du Pakistan à développer une infrastructure de recharge robuste et à susciter l’adhésion des consommateurs à ces technologies encore méconnues. L’exemple de BYD, qui a su conquérir 80 marchés mondiaux, enseigne qu’une ambition bien menée peut transformer les obstacles en tremplins.
En somme, par cette usine à Karachi, BYD ne se borne pas à investir ; il propose au Pakistan un manuel vivant de la transition énergétique. Ce chantier de vingt milliards de dollars, alliance entre vision chinoise et potentiel pakistanais, pourrait redessiner les contours d’un pays en quête de renouveau. L’avenir dira si cette graine, plantée dans le sol du Sindh, germera en un modèle durable, ouvrant une voie que d’autres pourraient emprunter.



 Diffa, terre de défis et d’espérance
Diffa, terre de défis et d’espérance
 Bryan C. Black : un théâtre de bravoure face à l’adversité
Bryan C. Black : un théâtre de bravoure face à l’adversité Une fraternité scellée dans le sacrifice
Une fraternité scellée dans le sacrifice
 Pavillon Présidentiel de l’Aéroport : un espace stratégique au service du rayonnement national
Pavillon Présidentiel de l’Aéroport : un espace stratégique au service du rayonnement national Le président Tiani impulse une transformation stratégique
Le président Tiani impulse une transformation stratégique En somme, ce projet d’embellissement du Pavillon Présidentiel à l’Aéroport Diori Hamani consacre une ambition noble : ériger un Niger moderne, où les lieux stratégiques reflètent la grandeur d’une nation en marche. Sous la conduite éclairée du président Tiani et grâce à l’expertise de l’Agence de Modernisation des Villes, cet espace s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire, alliant héritage et avenir avec une harmonie rare.
En somme, ce projet d’embellissement du Pavillon Présidentiel à l’Aéroport Diori Hamani consacre une ambition noble : ériger un Niger moderne, où les lieux stratégiques reflètent la grandeur d’une nation en marche. Sous la conduite éclairée du président Tiani et grâce à l’expertise de l’Agence de Modernisation des Villes, cet espace s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire, alliant héritage et avenir avec une harmonie rare.
 Makalondi : une communauté ébranlée, un exode silencieux
Makalondi : une communauté ébranlée, un exode silencieux
 Kimba Tahirou : une investiture empreinte de grandeur
Kimba Tahirou : une investiture empreinte de grandeur Un parcours d’exception sous les feux de la gloire
Un parcours d’exception sous les feux de la gloire Kimba Tahirou : une nouvelle ère sous un ciel d’espérance
Kimba Tahirou : une nouvelle ère sous un ciel d’espérance
 Une caravane d’émerveillement au cœur de la savane
Une caravane d’émerveillement au cœur de la savane Des voix unies dans l’exaltation à Kouré
Des voix unies dans l’exaltation à Kouré À ses côtés, Mme Mama Keita, ambassadrice du système des Nations Unies au Niger, a laissé éclater son enchantement. « Mes yeux ont capturé une splendeur qui défie les mots, et je suis honorée d’avoir été conviée à cette célébration de la vie », a-t-elle confié, le sourire illuminant son visage. Pour elle, cette excursion transcende le plaisir des sens : « Kouré est une promesse, un levier pour diversifier l’économie au-delà des richesses enfouies dans le sol. » Elle a rêvé à voix haute d’un avenir dans lequel hôtels, auberges et champs verdoyants fleuriraient autour de ce sanctuaire, portés par un tourisme florissant et une paix durable.
À ses côtés, Mme Mama Keita, ambassadrice du système des Nations Unies au Niger, a laissé éclater son enchantement. « Mes yeux ont capturé une splendeur qui défie les mots, et je suis honorée d’avoir été conviée à cette célébration de la vie », a-t-elle confié, le sourire illuminant son visage. Pour elle, cette excursion transcende le plaisir des sens : « Kouré est une promesse, un levier pour diversifier l’économie au-delà des richesses enfouies dans le sol. » Elle a rêvé à voix haute d’un avenir dans lequel hôtels, auberges et champs verdoyants fleuriraient autour de ce sanctuaire, portés par un tourisme florissant et une paix durable. Un festin de culture et de mémoire à Kouré
Un festin de culture et de mémoire à Kouré Ces girafes, sauvées de l’oubli par une volonté indomptable, ne sont pas de simples hôtes de la savane : elles incarnent un pilier d’identité, un vecteur de cohésion et une manne économique pour un pays décidé à briller sur la scène mondiale. Leur survie, fruit d’une alliance entre l’État, les riverains et des âmes bienveillantes venues d’ailleurs, est un hymne à l’espoir, une preuve que la beauté peut triompher des ombres.
Ces girafes, sauvées de l’oubli par une volonté indomptable, ne sont pas de simples hôtes de la savane : elles incarnent un pilier d’identité, un vecteur de cohésion et une manne économique pour un pays décidé à briller sur la scène mondiale. Leur survie, fruit d’une alliance entre l’État, les riverains et des âmes bienveillantes venues d’ailleurs, est un hymne à l’espoir, une preuve que la beauté peut triompher des ombres. Un prélude à d’autres conquêtes
Un prélude à d’autres conquêtes
 Une célébration portée par l’âme du fleuve
Une célébration portée par l’âme du fleuve Une mosaïque d’animations et d’hommages au bord du fleuve
Une mosaïque d’animations et d’hommages au bord du fleuve  Une fraternité scellée par les invités d’honneur
Une fraternité scellée par les invités d’honneur Un écrin de promesses pour demain
Un écrin de promesses pour demain