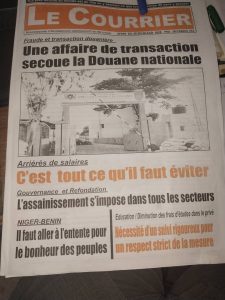Soulèvement au Népal : La génération Z fait trembler Katmandou : entre censure, colère et répression, le pays bascule.
Katmandou, 9 septembre 2025 – Le Népal traverse une crise sans précédent, marquée par les troubles civils les plus meurtriers depuis des décennies. En seulement quelques jours, des manifestations menées par la génération Z ont ébranlé le pays, faisant au moins 19 morts et des centaines de blessés, et poussant le Premier ministre KP Sharma Oli à la démission. À l’origine de cette révolte ? Une colère profonde contre la corruption, le népotisme et une interdiction brutale des réseaux sociaux. Voici ce qu’il faut retenir pour comprendre ce soulèvement historique et ses implications.

La censure des réseaux sociaux, l’étincelle qui a mis le feu aux poudres
Le 4 septembre 2025, le gouvernement népalais a interdit 26 plateformes de médias sociaux, dont Facebook, Instagram et X, pour non-respect des règles d’enregistrement. Cette décision, justifiée par des préoccupations de « sécurité nationale », a été perçue comme une tentative de museler les critiques en ligne. Ces critiques, portées par les jeunes sur des plateformes comme TikTok, dénonçaient le népotisme et le train de vie luxueux des enfants des élites politiques, dans un pays où 20 % de la population vit sous le seuil de pauvreté.
En réponse, la jeunesse, âgée de 13 à 28 ans, s’est mobilisée en masse, organisant des manifestations décentralisées et sans leader clair. À Katmandou, Biratnagar et Pokhara, des dizaines de milliers de jeunes sont descendus dans les rues avec des slogans percutants comme « Stop à la corruption » ou « Oli, voleur, quitte le pays ». Ces rassemblements, amplifiés par les réseaux sociaux avant leur interdiction, ont révélé une frustration accumulée face à l’inaction du gouvernement sur la corruption et le chômage des jeunes, qui atteint 20 % selon la Banque mondiale.
La répression brutale sème la mort et le chaos au Népal
Le 8 septembre, la situation a pris une tournure dramatique. Les manifestants ont pénétré une zone interdite près du Parlement à Katmandou. Les forces de sécurité ont alors répondu avec une violence sans précédent, utilisant des canons à eau, des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et, selon Amnesty International, des tirs à balles réelles. Des tirs à balles réelles et l’usage de la force ont tué au moins 19 personnes, principalement des jeunes, et en ont blessé plus de 400.
Les hôpitaux de la capitale ont été submergés. « Je n’ai jamais vu une situation aussi perturbante à l’hôpital », a déclaré une responsable de l’hôpital des fonctionnaires, Ranjana. Pire encore, les gaz lacrymogènes ont atteint les zones hospitalières, entravant le travail des médecins. Un jeune manifestant, Iman Magar, 20 ans, a témoigné avoir été touché par une balle métallique, perdant une partie de sa main.


L’escalade de la colère fait chuter le Premier ministre
Ce 9 septembre, la situation a connu une nouvelle escalade. Des manifestants ont incendié la résidence privée du Premier ministre Oli à Balkot, ainsi que plusieurs bureaux administratifs dans d’autres villes. Ils ont également pris pour cible les sièges des partis au pouvoir. Face à cette flambée de violence, le gouvernement a instauré des couvre-feux dans plusieurs localités et a partiellement fermé l’aéroport international de Katmandou.
Sous une pression croissante, le Premier ministre KP Sharma Oli a annoncé sa démission, qualifiant la situation d’« extraordinaire » dans une lettre publiée en ligne. Le ministre de l’Intérieur, Ramesh Lekhak, avait déjà démissionné la veille. Pour apaiser les tensions, le gouvernement a également levé l’interdiction des réseaux sociaux dans la nuit du 8 au 9 septembre.
Une crise historique : la jeunesse se lève contre l’establishment
Ces manifestations, surnommées les « protestations de la génération Z », sont considérées comme les plus importantes de l’histoire moderne du Népal. Contrairement aux mouvements précédents, souvent dirigés par des partis politiques, celles-ci sont largement spontanées et portées par une jeunesse connectée, frustrée par des décennies de corruption et d’instabilité. Ce soulèvement vise particulièrement les trois principaux leaders politiques – Oli, Prachanda et Deuba – qui se relaient au pouvoir depuis des années, en raison de leur incapacité à répondre aux attentes de la population.
Le Népal, avec un revenu par habitant de seulement 1 400 dollars par an, souffre d’une fracture sociale marquée. Les campagnes sur les réseaux sociaux ont mis en lumière les privilèges des « nepo kids » – les enfants des élites – alimentant un sentiment d’injustice. Les Népalais ont perçu la décision de bloquer les plateformes, que 14,3 millions d’entre eux utilisent, comme une attaque contre leur liberté d’expression, un droit garanti par la Constitution népalaise.

Le Népal face à ses défis : la suite en suspens
Cette crise met en lumière plusieurs enjeux cruciaux. D’abord, la colère de la jeunesse, qui exige une gouvernance transparente et des opportunités économiques. Ensuite, la répression excessive, condamnée par des organisations comme Amnesty International. Enfin, la fragilité politique, qui révèle la précarité de la coalition au pouvoir. Le parti RSP, quatrième force politique, demande d’ores et déjà des élections anticipées.
Le gouvernement a annoncé des aides financières pour les familles des victimes, des soins gratuits pour les blessés et une commission d’enquête. Cependant, les manifestants continuent d’organiser des rassemblements en mémoire des victimes, défiant les couvre-feux. L’ONU, par la voix de sa coordinatrice Hanaa Singer-Hamdy, s’est dite prête à soutenir le Népal pour rétablir le calme.
Cette crise est historique, car elle rappelle que la liberté d’expression et la lutte contre la corruption sont des aspirations fondamentales pour une nouvelle génération qui refuse de se taire. La chute d’Oli marque un tournant. Reste à savoir si les dirigeants népalais sauront tirer les leçons de cette crise pour bâtir un avenir plus juste, ou si ces réformes seront une nouvelle fois remises à plus tard. Dans un pays habitué aux bouleversements, le silence de la rue est-il un gage de paix durable, ou le prélude à une nouvelle confrontation ?