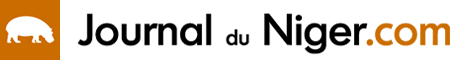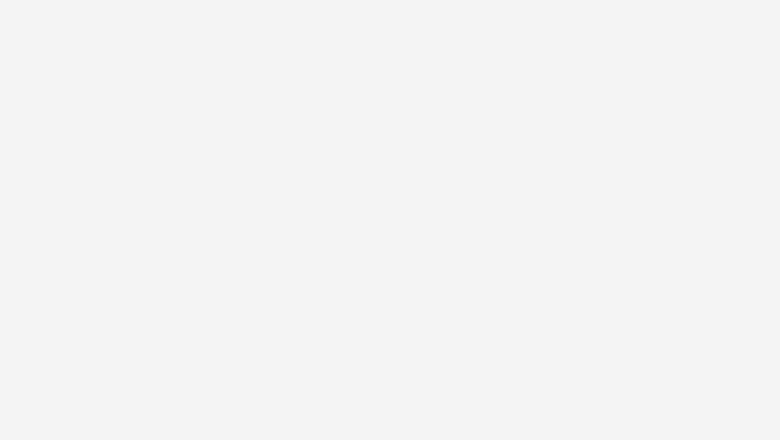Moustapha, 12 ans, et Ines, 9 ans, aident leurs parents à charger le pick-up avant de fuir, une nouvelle fois, l’offensive meurtrière du régime dans le nord-ouest de la Syrie. Soudain, un bombardement à quelques rues de là sème la panique.
Instinctivement, Moustapha rentre la tête dans les épaules et se précipite dans le véhicule où sont empilés tapis et couvertures, suivi par sa soeur terrorisée qui se bouche les oreilles.
Une scène banale pour cette région, où les tirs d’artillerie et raids aériens du régime et son allié russe ont provoqué depuis deux mois un exode d’une ampleur sans précédent.
« Notre vie se résume à ça: des bombardements et la peur », lâche Abou Mohamed, le père de Moustapha et Inès.
La famille vivait depuis à peine un mois à Daret Ezza, dans la campagne vallonnée de l’ouest de la province d’Alep, un secteur dominé par des jihadistes et des rebelles visés par l’offensive du régime.
Originaire du sud de la province voisine d’Idleb, Abou Mohammed ne compte plus le nombre de fois où sa famille a été déplacée par les violences.
« C’est notre peur pour les enfants qui nous pousse à partir », lâche le quinquagénaire aux cheveux poivre et sel.
– « Elle hurle » –
Lorsque la famille est arrivée à Daret Ezza, elle a pris ce qui se présentait comme hébergement: un atelier aux murs noircis, où l’unique pièce était séparée de la cour par une bâche déchirée.
« C’est tout ce qu’on pouvait s’offrir », explique Abou Mohamed, qui raconte que les enfants, déjà affaiblis, ont souffert de la grippe et d’autres maladies.
Depuis début décembre, près de 900.000 personnes selon l’ONU, en majorité des femmes et des enfants, ont été déplacées par l’offensive du régime lancée contre la province d’Idleb et les territoires limitrophes, ultime grand bastion jihadiste et rebelle de Syrie.
« On ne peut calmer les enfants quand ils entendent le bruit d’un avion ou d’un obus », poursuit Abou Mohamed.
Inès, petite chose emmitouflée dans un anorak sombre et bonnet vert enfoncé sur la tête, est la plus traumatisée des quatre enfants encore à la maison, selon son père.
La nuit, elle met sa tête sous l’oreiller pour ne pas entendre les avions.
« Elle se fige totalement pendant les bombardements », raconte Abou Mohamed. « Je lui bouche les oreilles et je lui dit +n’ai pas peur, c’est loin d’ici, il n’y aura pas de frappes+. Mais elle hurle et elle pleure », soupire le père.
La famille ne sait pas encore où elle va vivre, mais elle va rallier la région d’Aazaz, au nord de Daret Ezza, et considérée comme plus sûre car située à la frontière turque.
« On logera peut-être avec mon cousin qui a pris une tente en partant », dit Abou Mohammed.
Faute de place dans le pick-up, la famille a été contrainte d’abandonner une cuisinière, des bassines, des marmites et une machine à coudre. Et comme la cabine ne peut accueillir tout le monde, certains doivent faire le voyage dans l’arrière du véhicule, juchés sur un tas d’affaires.
– « Comment les calmer? » –
Les organisations humanitaires ne cessent de tirer la sonnette d’alarme sur les traumatismes psychologiques subis en Syrie par les enfants, qui perdent leur maison, leur école, et voient parfois mourir leurs proches.
L’ONG Save the Children, qui a fait état de la mort de sept enfants dans le nord-ouest, dont un bébé, a averti que le nombre de décès pourrait augmenter vu les conditions « inhumaines » dans lesquelles vivent les déplacés.
Plus de 400 civils, dont 112 enfants, ont par ailleurs été tués depuis la mi-décembre dans les bombardements, selon l’Observatoire syrien des droits de l’Homme (OSDH).
A Daret Ezza, Abou Ahmed se prépare lui aussi à prendre la route avec ses cinq enfants, dont le plus jeune a sept ans.
Aidé par un de ses fils, un rouquin à la silhouette frêle, il charge une camionnette de ses maigres possessions sans savoir où il va aller.
Les enfants sont « terrorisés », par les bombardements, confie-t-il. Il se souvient encore des frappes particulièrement violentes dans la nuit de lundi.
« Les enfants ont couru se réfugier dans les bras de leur mère et dans les miens », raconte-t-il. « Ils hurlaient et ils pleuraient, on ne savait pas comment les calmer ».