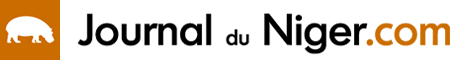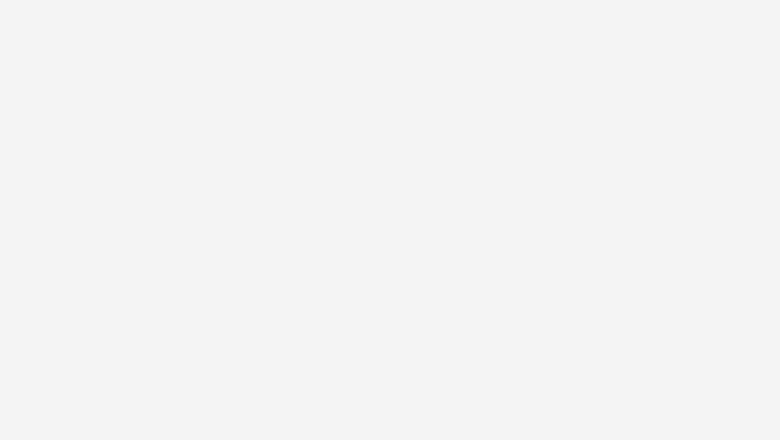Dans une oliveraie ensoleillée du nord-ouest syrien, Chamseddine Darra descend une volée de marches qui s’enfoncent sous terre. Fuyant l’offensive du régime, lui et sa famille n’ont eu d’autre choix que de s’installer dans une caverne.
Le trentenaire partage avec ses trois frères et leur famille cette « grotte » exiguë, creusée au milieu des champs vallonnés de la région d’Idleb, près du village de Taltouna.
Ils ont abandonné leur maison il y a deux semaines dans l’est de cette province pour échapper aux bombardements meurtriers du régime de Bachar al-Assad et de son allié russe, qui ont repris en décembre leur assaut contre l’ultime grand bastion jihadiste et rebelle de Syrie.
« On vit ici contre notre gré », lâche le Syrien à la barbe fournie.
« On n’avait pas de tentes. On est resté deux jours dans la mosquée du village, on a cherché un abri mais on n’a rien trouvé », ajoute ce père de huit enfants.
Ils habitent donc ce souterrain inoccupé, creusé par les villageois dans la roche du sol pour s’y réfugier en cas de bombardements.
Ils y vivent dans une pénombre permanente. La cave est éclairée uniquement par la lumière qui parvient de l’entrée. Au sol sont étalés un grand tapis et des matelas en mousse.
Assis en cercle, les enfants et les adultes petit-déjeunent, plongeant un morceau de pain dans les assiettes de houmous et de zaatar.
Dans un coin, leurs affaires s’entassent sous une couverture rouge. A l’extérieur, un panneau solaire permet de fournir un peu d’électricité.
« On souffre de l’humidité, les enfants sont malades, il y a aussi des insectes », regrette M. Darra, emmitouflé dans un sweat à capuche noir.
– « Pas d’autres choix » –
En raison des violences, quelque 900.000 personnes ont été déplacées depuis début décembre dans le nord-ouest syrien, selon l’ONU.
Parmi elles, 170.000 civils vivent en plein air ou dans des bâtiments inachevés, faute d’avoir pu trouver un logement ou une tente dans les camps de déplacés bondés.
Abou Mohamed partage avec ses proches une grotte souterraine près de Taltouna, après avoir fui son village dans l’ouest de la province voisine d’Alep.
Ils sont une quarantaine de personnes au total. Dans un coin, des bocaux de provisions s’alignent. Assises sur un tapis en jute, les femmes préparent à manger. L’une d’elles mélange des légumes en sauce tomate à des morceaux d’une sorte de mortadelle, sur un réchaud à gaz.
A leur arrivée, « la grotte était sale, il y avait des excréments d’animaux » se souvient Abou Mohamed.
« Les habitants du village nous ont prévenu qu’il y avait des scorpions et des serpents, mais on n’avait pas d’autres choix », déplore ce quadragénaire à la barbe et aux cheveux grisonnants.
Régulièrement, des correspondants de l’AFP rencontrent des civils contraints de passer la nuit dans leur voiture malgré les températures hivernales, ou installés dans des écoles, des mosquées, voire des prisons désaffectées, transformées en abri temporaire.
– « Peur de la mort » –
A Sarmada, dans le nord d’Idleb, une soixantaine de familles s’entassent dans le funérarium d’un cimetière.
Le jour, quand la météo le permet, hommes et femmes se dégourdissent les jambes dans les allées, ou s’assoient dans l’herbe avec leurs enfants, près des pierres tombales en marbre blanc.
Le vaste hall funéraire lumineux, chauffé grâce à plusieurs poêles, a été divisé en deux sections, une pour les femmes et une pour les hommes.
Les pleurs des nourrissons se mêlent au brouhaha des conversations. Ici et là, des affaires sont entassées pêle-mêle: des matelas, des tapis, des casseroles et des réserves de nourriture.
« Il y a beaucoup de familles à l’intérieur », soupire Youssra Harssouni, posée près d’une tombe avec deux petits.
Elle reconnaît que cette proximité avec la mort suscite des frayeurs.
Une nuit, un enfant s’est mis à hurler et les gens ont pensé qu’il était habité par un esprit, raconte-t-elle.
« Le cheikh est venu lire le Coran à deux reprises », poursuit la grand-mère, enveloppée dans des voiles noirs qui ne dévoilent que son visage et ses mains.
Elle s’est toutefois résignée à cette cohabitation.
Ayant fui les bombardements sur la ville d’Ariha avec sa belle-fille et ses petits-enfants, elle vit ici depuis une dizaine de jours.
« Bien sûr, au milieu des tombes, il y a la peur de la mort », admet-elle. « Mais bon, entre la peste et le choléra… », confie-t-elle, fataliste.
strs-tgg/mdz