Niamey, 20 février 2025 —Alors que le soleil déclinant de février éclairait les murs du Centre Mahatma Gandhi à Niamey, les ultimes échanges des Assises Nationales pour la Refondation du Niger se sont clos ce jeudi, marquant l’aboutissement d’une démarche inédite dans l’échiquier politique sahélien. Sous l’égide du Conseil National pour la Sauvegarde de la Patrie (CNSP), cette agora de six jours, rassemblant 716 délégués issus de toutes les strates socioprofessionnelles, a produit un corpus de recommandations oscillant entre audace réformatrice et quête d’équilibre. Elle a esquissé les contours d’un Niger post-transitionnel, naviguant entre réconciliation interne et réaffirmation souveraine sur la scène internationale.
 Une synthèse des aspirations plurielles
Une synthèse des aspirations plurielles
Porté par une rhétorique empreinte de solennité, le Général Abdourahamane Tiani, Président du CNSP, a salué un « processus cathartique, libérant les énergies latentes d’une nation en quête de renaissance ». Les travaux, démarrés le 15 février, ont disséqué avec une minutie chirurgicale les maux structurels du pays : exploitation des ressources naturelles, fragilités sécuritaires, déliquescence des institutions, ou encore les fractures sociétales héritées de décennies de gouvernance contestée. La Charte de la transition, document-phare issu de ces délibérations, se veut une boussole éthique pour une gouvernance renouvelée, ancrée dans la transparence et l’équité.
 Refondation Juridique : entre clémence et redressement
Refondation Juridique : entre clémence et redressement
Parmi les propositions les plus audacieuses, celles de la sous-commission « Justice et Droits de l’Homme » ont cristallisé les tensions entre pardon collectif et exigence de reddition des comptes. Recommandant une amnistie pour les acteurs du putsch de juillet 2023 et une grâce pour les militaires condamnés pour tentative de déstabilisation, cette instance a néanmoins plaidé pour une traque implacable des détournements massifs de l’Uranium-gate au MDN-gate. Cette dualité reflète une volonté de concilier réconciliation nationale et exigence de reddition des comptes.
Par ailleurs, les délégués ont plaidé pour un réarmement moral de l’appareil judiciaire : réforme du Conseil supérieur de la magistrature, alignement des conditions de nomination des magistrats du parquet sur ceux du siège et création d’un pôle spécialisé autonome pour les crimes économiques. L’abolition des immunités parlementaires et des privilèges de juridiction vise à rompre avec une culture d’exception, tandis que l’intégration des mécanismes traditionnels de règlement des litiges reconnaît la pluralité des légitimités.
En parallèle, la sous-commission a réclamé la résurgence de vérités historiques enfouies : l’assassinat du président Baré Maïnassara en 1999, les massacres estudiantins de 1990 ou les attaques de Téra et Chinagoder. Une exigence de mémoire qui se double d’un geste symbolique : la restauration du Ministère de la Promotion de la Femme, marqueur d’une justice du genre longtemps négligée.
 Géopolitique : vers une nouvelle alliance sahélienne
Géopolitique : vers une nouvelle alliance sahélienne
Sur le front diplomatique, les assises ont acté un virage stratégique. La sous-commission « Géopolitique et Environnement International » a esquissé une doctrine étrangère recentrée sur l’alliance sahélo-saharienne. Prônant l’élaboration d’une politique extérieure axiomatique ancrée dans la Confédération des États du Sahel (AES), les délégués ont appelé à un réalignement des représentations diplomatiques, à la fermeture des ambassades « sans intérêt stratégique » et à la priorité aux partenariats au sein de la CEDEAO.
L’opérationnalisation de l’AES passerait par la tenue d’États généraux de la diplomatie et l’intégration des cadres admis aux concours des Affaires étrangères, comblant ainsi un déficit chronique de professionnalisme. En plus, le projet phare est un forum annuel de la diaspora, conçu comme un levier économique et culturel visant à transformer une communauté exilée en ambassadrice d’un Niger réinventé.
Cette réorientation, saluée par le Ministre malien de la Refondation de l’État, Bakary Traoré, s’inscrit dans une logique de solidarité anticoloniale, selon ses termes, où Niamey et Bamako entendent incarner un front uni face aux ingérences extérieures.
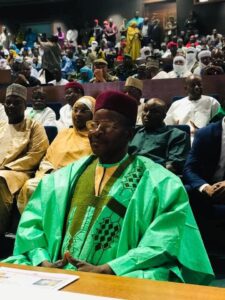 Refondation politique : de la table rase à l’édification institutionnelle
Refondation politique : de la table rase à l’édification institutionnelle
La Commission « Refondation politique et institutionnelle » a, quant à elle, frappé les esprits en préconisant la dissolution des partis politiques existants et l’instauration d’un multipartisme contrôlé, encadré par une charte redessinée. Cette mesure radicale, justifiée par la chronicité des clientélismes, s’accompagne aussi d’une refonte constitutionnelle reconnaissant l’islam comme religion majoritaire tout en garantissant la liberté de culte, équilibre délicat entre identité et pluralisme.
Le projet institutionnel inclut une cure d’austérité : limitation à 100 députés avec quota féminin contraignant, réduction des ministères à 20 départements et création d’une Cour de répression des infractions économiques, gage de transparence. La dépolitisation de l’administration publique et la suppression des privilèges juridictionnels entendent également restaurer l’égalité citoyenne, pilier d’un contrat social érodé.
 L’espérance à l’épreuve des réalisations
L’espérance à l’épreuve des réalisations
Si ces assises ont offert un exutoire aux frustrations accumulées, leur héritage dépendra de la traduction des résolutions en actes tangibles. Le défi est double : incarner une justice réparatrice sans sombrer dans la vendetta politique et bâtir une souveraineté régionale sans s’isoler diplomatiquement. En convoquant l’adhésion populaire et en s’inspirant des traditions délibératives locales, le Niger tente d’écrire un chapitre dans lequel légitimité interne et affirmation géopolitique se nourrissent mutuellement. Reste à savoir si cette feuille de route, ambitieuse, mais fragile, résistera aux secousses d’un Sahel en perpétuelle ébullition,ou si elle restera lettre morte, étouffée par les pesanteurs d’un système résilient.
En somme, dans l’ombre du Centre Mahatma Gandhi, symbole de résistance non violente, le Niger tente d’écrire une nouvelle grammaire politique. Un lexique où justice rime avec rédemption, souveraineté avec interdépendance, et où chaque mot, amnistie, dissolution, confédération, porte le poids d’un avenir à inventer. L’histoire, sévère arbitre, jugera si cette transition aura été un interlude ou une renaissance.




